

CONTES ET RENCONTRES
MARDI 3 FEVRIER
A 20h30 :
"Grandiloquent Moustache poésie club"
Salle des fêtes
de Sainte-Enimie
Télécharger le programme ici
- LE DIMANCHE 1ER FEVRIER 2015 A 14H
LOTO DE L'ECOLE PRIMAIRE
SALLE DES FETES DE SAINTE-ENIMIE
Du 28 au 31 Janvier un groupe d'élèves du collège Pierre Delmas vont participer au festival de bande-dessinée à Angoulême.
Depuis la rentrée scolaire une quinzaine d'élèves de l'établissement participent à un atelier hebdomadaire où ils ont pu réaliser chacun leur propre bande-dessinée et ainsi découvrir les étapes de la création (story-board, recherches graphiques, colorisation, élaboration du texte...).
C'est parmi ces jeunes artistes en herbe que huit jeunes ont été sélectionnés par un jury constitué d'enseignants, de membres de la direction et du dessinateur Xavier Boulot qui les a accompagnés tout au long de cet atelier.
Les heureux lauréats vont avoir la chance de rencontrer des auteurs, des scénaristes, des éditeurs et de consolider leur connaissance du genre préféré des adolescents. Ils seront également concurrents dans la catégorie collège du festival.
Nous leur souhaitons un bon séjour !
« CALIXTE » et « GUSTETO » cultivaient les terres de l’AIGUEBELLE du vivant de ma grand-mère. Ils n'étaient pas des ouvriers agricoles, au sens où nous l’entendons aujourd’hui, mais des villageois que l’on appelait, lorsque les travaux des champs, ou la culture de la vigne l’exigeaient. Des « journaliers », disait-on.
CALIXTE était petit et gros. Il portait une ceinture de flanelle rouge, qu’il roulait et déroulait avec grand soin, tant il était conscient qu’elle participait à son bien être, et assurait le maintien de sa dignité.Il était de surcroit anticlérical, par posture, plutôt que par conviction véritable.
Le curé de la paroisse, revêtu de sa redingote noire et de son bonnet carré, passait parfois dans les parages, au cours de sa promenade quotidienne, en lisant son bréviaire. Lorsqu’il l’apercevait, Calixte s’exclamait à l’adresse de Gusteto : « té ; beijo lou groupatas qué passo » (tiens ; regarde le gros corbeau qui passe). Il s’affairait, alors, sur sa besogne et se penchait en avant pour n’avoir pas à le saluer.
« GUSTETO » était grand et maigre ; il aurait pu figurer sur le tableau de MILLET, dit « l’ANGELUS ». Debout, les 2 mains sur sa pioche, appelée « harpe », il attendait un regard du prélat, pour ôter sa casquette, en signe de déférente salutation ; cela le rassurait, lui donnait bonne conscience, et exorcisait le comportement de son compagnon mécréant.
Tout deux travaillaient à leur rythme, sans excès, mais soucieux d’accomplir et terminer leur ouvrage, avant la tombée du jour.
A l’heure de la pose, la grand-mère leur apportait dans un panier d’osier, tapissé d’une toile de jute, un morceau de fromage, et une bouteille de vin clairet de la récolte précédente.
C’était le moment d’échanger sur la vie locale, avec complaisance ou ironie, selon les jours, jusqu’au moment où retentissait un solide « Gusteto, baïsso-ti ». C’était la voix de la grand’mère qui dictait la fin du repos. (baïsso-ti signifiait « travaille ! ».
Ils étaient tous attachés à la terre dont ils étaient les serviteurs. Ils n’en tiraient ni gloire ni profit. C’était leur condition, et ils l’acceptaient.
Ceux là s’en sont allés, emportant avec eux une ruralité qui ne trouve plus sa place.
La terre, elle, est restée. Même endroit, mêmes contraintes, mêmes exigences, mêmes sacrifices, pour un monde qui va vite, … si vite… trop vite…
Germaine Drighès
Paris le 17/01/2015



François Malaval et Geneviève Solier lors d'un bal des pompiers
Merci à Pascal pour la photo

Extrait de son livre
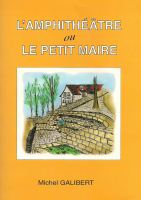
Est-ce que le MSG dans la nourriture chinoise est susceptible de vous donner un mal de tête ?
Réponse courte: Non
Après 40 ans d'essais en cliniques, publiés dans le Journal de l'Académie américaine des infirmières praticiennes en 2006 ,
Ont trouvé que dans toutes les recherches antérieures c’était Impossible d'identifier une relation constante entre la consommation de MSG
et la constellation de symptômes qui constituent le syndrome, y compris les maux de tête et les crises d'asthme.
L'idée fausse a engendré plusieurs études mal faites dans les années 1960 qui semblait se connecter MSG avec une variété de maladies que les gens avaient connu après avoir mangé dans des restaurants chinois.
En savoir plus sur le mythe de MSG ici »
Est-ce bon ?

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et du Traitement des Ordures Ménagère, s'occupe de la déchetterie de Sainte-Enimie où de nombreux travaux ont eu lieu, vous trouverez à télécharger ici le dernier compte rendu
Les brèves de Michel G.

Les « Stories » de Michel G.
Cette semaine Michel G.
vous fais partager une de ses «brèves»
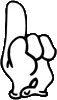


Edito du 30 janvier 2015
Cette semaine :
Les recherches continuent…En vain ! Depuis plus de sept semaines, notre ami Santrimiol reste introuvable. De nouvelles plongées ont eu lieu dernièrement dans les gouffres profonds formés dans les méandres du Tarn près du village…Rien, aucun indice….Plusieurs radiesthésistes le voyaient ça ou là, tous les dires ont été vérifiés…L’appel à témoins n’a encore rien donné !
Ces enfants, sa famille, ses amis, ses proches, tous nous cherchons, nous avons besoin de savoir…
Aussi encore une fois, nous vous rappelons les faits :
Emile, 84 ans, n’est jamais revenu de sa promenade journalière le lundi 8 décembre 2014 après-midi.
Vous n’étiez peut-être pas encore au courant ? Il est toujours temps, rien ne vous sera reproché!
Si vous l’avez aperçu quelque part,aux alentours du village de Ste Enimie ou plus loin, pris ou vu monter dans un véhicule, MERCI de le signaler (tél : 17). Il était vêtu de bleu-marine, muni d’une canne .Il portait une casquette…Rappelez-vous ce lundi gris…S’il vous plaît, Réfléchissez…Essayez de vous souvenir…Regardez bien la photo...Cette mystérieuse disparition est tellement dramatique pour son épouse, ses enfants, petits-enfants… pour toute notre commune !
SICTOM
Réponse du qui est qui de la semaine dernière
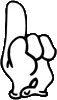
Emile Malaval toujours disparu !…
LOZERE : PORTRAITS
Le Collège de Sainte Enimie
au festival d'Angoulême
lasantrimiole.fr / Xiane
Les news Santrimioles
Recherche:
Brèves et info locales de Sainte-Enimie (48) Lozère - France


Copyright 2012
La Santrimiole - Xiane - Sainte-Enimie